anastasia beschi
Aux frontières du perceptible
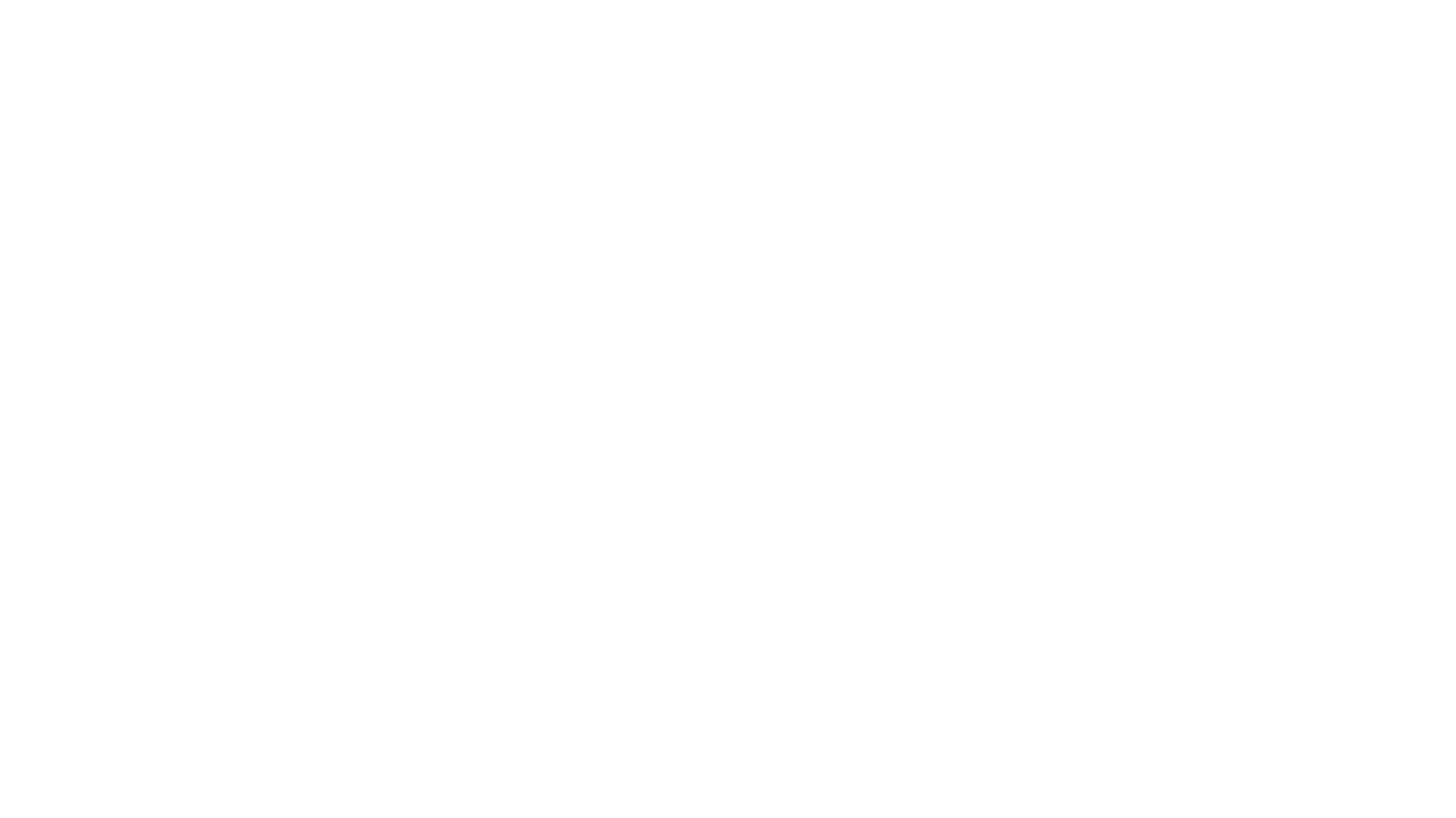
Et si le problème ne venait pas du sujet, mais du système de vision dans lequel il est contraint de s’inscrire ?
Il est des malaises qu’aucun diagnostic ne saisit, des décalages que nul vocabulaire clinique ne suffit à épingler. Une forme de discordance intime — non spectaculaire, mais persistante — traverse certaines subjectivités avec une précision quasi géométrique : celle de ne pas tout à fait voir le même monde que les autres, ni de pouvoir s’y inscrire sans violence intérieure.
Ce trouble ne relève pas du pathologique. Il échappe aux typologies psychologiques conventionnelles. Il ne se manifeste pas par des symptômes mesurables, mais par une dérive infra-perceptible de l’attention, une impression constante que "quelque chose ne colle pas" entre l’expérience vécue et les formes admises de son expression.
La première tentation est de rabattre ce malaise sur l’individu lui-même — erreur de perspective, fragilité personnelle, inadéquation aux normes du visible.
Mais une autre hypothèse, plus difficile à soutenir, surgit lorsque ce sentiment persiste malgré tous les ajustements : et si le problème ne venait pas du sujet, mais du système de vision dans lequel il est contraint de s’inscrire ? Ce doute — radical en ce qu’il remet en cause non pas ce que l’on perçoit, mais les conditions mêmes de la perception — constitue le point de bascule de ce que nous proposons d’appeler ici la psychooptique. Car il existe un impensé fondamental dans nos épistémologies modernes : le statut du visible comme donné neutre.
La plupart des approches scientifiques et philosophiques considèrent la réalité comme une matière préexistante, et la conscience comme un miroir plus ou moins fidèle. Or cette conception suppose un oubli majeur : celui des filtres collectifs, historiques, culturels, langagiers et attentionnels qui précèdent et conditionnent toute mise en forme du monde. Autrement dit, nous ne percevons jamais directement.
Nous percevons à travers un système optique partagé, stabilisé, normatif, qui détermine non seulement ce qui est visible, mais aussi ce qui mérite de l’être, ce qui peut être nommé, pensé, transmis.
Ce que nous appelons "réalité" est donc l’effet d’une lentille collective, non d’un accès brut au monde. Et ce que nous tenons pour subjectif — l’étrangeté d’un ressenti, la précocité d’une intuition, la difficulté à s’ajuster au visible commun — n’est peut-être rien d’autre qu’un défaut d’alignement avec l’optique dominante.
Dès lors, un renversement s’impose : et si l’individu dit “en décalage” n’était pas déficient, mais simplement exposé à un autre plan de lisibilité — encore non intégré, encore illégitime, mais néanmoins réel ?
La psychooptique prend naissance dans ce soupçon. Non pas comme système clos, ni comme théorie du tout, mais comme cartographie critique des régimes de visibilité qui structurent notre rapport au monde, aux autres, à nous-mêmes. Elle ne propose pas de vérité nouvelle. Elle tente simplement de décrire ce moment précis — liminal, instable, non consolidé — où la perception intérieure ne trouve plus appui dans les cadres extérieurs. Ce moment où la conscience, sans l’avoir voulu, s’est rapprochée de la frontière du perceptible.
Ce trouble ne relève pas du pathologique. Il échappe aux typologies psychologiques conventionnelles. Il ne se manifeste pas par des symptômes mesurables, mais par une dérive infra-perceptible de l’attention, une impression constante que "quelque chose ne colle pas" entre l’expérience vécue et les formes admises de son expression.
La première tentation est de rabattre ce malaise sur l’individu lui-même — erreur de perspective, fragilité personnelle, inadéquation aux normes du visible.
Mais une autre hypothèse, plus difficile à soutenir, surgit lorsque ce sentiment persiste malgré tous les ajustements : et si le problème ne venait pas du sujet, mais du système de vision dans lequel il est contraint de s’inscrire ? Ce doute — radical en ce qu’il remet en cause non pas ce que l’on perçoit, mais les conditions mêmes de la perception — constitue le point de bascule de ce que nous proposons d’appeler ici la psychooptique. Car il existe un impensé fondamental dans nos épistémologies modernes : le statut du visible comme donné neutre.
La plupart des approches scientifiques et philosophiques considèrent la réalité comme une matière préexistante, et la conscience comme un miroir plus ou moins fidèle. Or cette conception suppose un oubli majeur : celui des filtres collectifs, historiques, culturels, langagiers et attentionnels qui précèdent et conditionnent toute mise en forme du monde. Autrement dit, nous ne percevons jamais directement.
Nous percevons à travers un système optique partagé, stabilisé, normatif, qui détermine non seulement ce qui est visible, mais aussi ce qui mérite de l’être, ce qui peut être nommé, pensé, transmis.
Ce que nous appelons "réalité" est donc l’effet d’une lentille collective, non d’un accès brut au monde. Et ce que nous tenons pour subjectif — l’étrangeté d’un ressenti, la précocité d’une intuition, la difficulté à s’ajuster au visible commun — n’est peut-être rien d’autre qu’un défaut d’alignement avec l’optique dominante.
Dès lors, un renversement s’impose : et si l’individu dit “en décalage” n’était pas déficient, mais simplement exposé à un autre plan de lisibilité — encore non intégré, encore illégitime, mais néanmoins réel ?
La psychooptique prend naissance dans ce soupçon. Non pas comme système clos, ni comme théorie du tout, mais comme cartographie critique des régimes de visibilité qui structurent notre rapport au monde, aux autres, à nous-mêmes. Elle ne propose pas de vérité nouvelle. Elle tente simplement de décrire ce moment précis — liminal, instable, non consolidé — où la perception intérieure ne trouve plus appui dans les cadres extérieurs. Ce moment où la conscience, sans l’avoir voulu, s’est rapprochée de la frontière du perceptible.
L’illusion d’un monde neutre
L’une des croyances les plus profondément ancrées dans la pensée moderne est celle d’un monde perçu comme fondamentalement neutre — stable, homogène, accessible à tous dans des conditions sensorielles comparables. Cette présupposition fonde les sciences empiriques, l’épistémologie rationaliste et une grande partie des modèles cognitifs : le réel serait là, indépendant, et la conscience n’aurait pour tâche que de l’observer, l’interpréter, puis s’y adapter.
Or, cette vision repose sur une abstraction majeure : elle ignore les conditions optiques préalables à toute perception. Elle suppose que ce qui est visible l’est de manière équitable, non filtrée, et que ce qui ne l’est pas relève de l’imaginaire, de l’erreur ou du non-sens.
La psychooptique, en rupture avec cette tradition, propose un retournement conceptuel : il n’y a pas de perception brute. Il n’y a que des focalisations. Autrement dit, ce que nous appelons "monde" — ou plus précisément, "monde visible" — est le produit d’un réglage collectif des seuils de visibilité. Ce réglage, largement inconscient, se construit à travers l’histoire des langages, les structures culturelles, les habitudes perceptives, les économies de l’attention, les technologies de vision et les récits dominants. Il détermine non seulement ce qui est vu, mais aussi ce qui a le droit d’être vu, et ce qui doit être occulté.
Le visible est donc politiquement, cognitivement et affectivement structuré. Il n’est jamais donné, mais toujours organisé — par des forces dont nous n’avons ni pleine conscience, ni véritable maîtrise.
Dès lors, la neutralité supposée du monde extérieur devient une illusion fonctionnelle : elle camoufle la violence douce du cadre, cette norme de lisibilité collective qui disqualifie, sans l’annoncer, toute perception divergente.
Celui ou celle qui voit autrement — que ce soit par sensibilité accrue, intuition anticipatrice ou perception transversale — n’est pas immédiatement perçu comme porteur d’un angle nouveau. Il est souvent marginalisé, pathologisé ou réduit à une subjectivité "trop" : trop sensible, trop abstraite, trop floue.
Et pourtant, ces écarts de vision ne sont peut-être pas des erreurs. Ils pourraient bien constituer les signaux faibles d’un changement dans la topologie du réel. Car le cadre du visible, s’il est efficace dans un contexte donné, peut devenir obsolète à mesure que d’autres zones de signifiance émergent, en silence, à travers les tensions du présent.
L’illusion d’un monde neutre fonctionne tant que la majorité s’y reconnaît. Mais dès qu’une part significative de subjectivités commence à ressentir un écart entre ce qu’elle vit et ce que le cadre permet de nommer, penser ou montrer — alors la stabilité du visible vacille. La psychooptique propose ici une lecture non clinique de ce vacillement : non pas comme une pathologie collective, mais comme un signe de saturation du régime perceptif dominant. Un moment où ce qui était jusque-là périphérique commence à exiger une place centrale,
non pour imposer un autre dogme, mais pour étendre la focale du réel, inclure ce qui, jusqu’ici, n’avait pu apparaître qu’en négatif : le flou, le silence, le trouble, l’intuition, le pré-verbal, le discontinu.
Il ne s’agit pas de célébrer l’obscur, ni de rejeter les cadres existants, mais de reconnaître que le visible est un produit historique, et qu’il peut — il doit — muter lorsque la conscience collective ne s’y loge plus sans perte.
Or, cette vision repose sur une abstraction majeure : elle ignore les conditions optiques préalables à toute perception. Elle suppose que ce qui est visible l’est de manière équitable, non filtrée, et que ce qui ne l’est pas relève de l’imaginaire, de l’erreur ou du non-sens.
La psychooptique, en rupture avec cette tradition, propose un retournement conceptuel : il n’y a pas de perception brute. Il n’y a que des focalisations. Autrement dit, ce que nous appelons "monde" — ou plus précisément, "monde visible" — est le produit d’un réglage collectif des seuils de visibilité. Ce réglage, largement inconscient, se construit à travers l’histoire des langages, les structures culturelles, les habitudes perceptives, les économies de l’attention, les technologies de vision et les récits dominants. Il détermine non seulement ce qui est vu, mais aussi ce qui a le droit d’être vu, et ce qui doit être occulté.
Le visible est donc politiquement, cognitivement et affectivement structuré. Il n’est jamais donné, mais toujours organisé — par des forces dont nous n’avons ni pleine conscience, ni véritable maîtrise.
Dès lors, la neutralité supposée du monde extérieur devient une illusion fonctionnelle : elle camoufle la violence douce du cadre, cette norme de lisibilité collective qui disqualifie, sans l’annoncer, toute perception divergente.
Celui ou celle qui voit autrement — que ce soit par sensibilité accrue, intuition anticipatrice ou perception transversale — n’est pas immédiatement perçu comme porteur d’un angle nouveau. Il est souvent marginalisé, pathologisé ou réduit à une subjectivité "trop" : trop sensible, trop abstraite, trop floue.
Et pourtant, ces écarts de vision ne sont peut-être pas des erreurs. Ils pourraient bien constituer les signaux faibles d’un changement dans la topologie du réel. Car le cadre du visible, s’il est efficace dans un contexte donné, peut devenir obsolète à mesure que d’autres zones de signifiance émergent, en silence, à travers les tensions du présent.
L’illusion d’un monde neutre fonctionne tant que la majorité s’y reconnaît. Mais dès qu’une part significative de subjectivités commence à ressentir un écart entre ce qu’elle vit et ce que le cadre permet de nommer, penser ou montrer — alors la stabilité du visible vacille. La psychooptique propose ici une lecture non clinique de ce vacillement : non pas comme une pathologie collective, mais comme un signe de saturation du régime perceptif dominant. Un moment où ce qui était jusque-là périphérique commence à exiger une place centrale,
non pour imposer un autre dogme, mais pour étendre la focale du réel, inclure ce qui, jusqu’ici, n’avait pu apparaître qu’en négatif : le flou, le silence, le trouble, l’intuition, le pré-verbal, le discontinu.
Il ne s’agit pas de célébrer l’obscur, ni de rejeter les cadres existants, mais de reconnaître que le visible est un produit historique, et qu’il peut — il doit — muter lorsque la conscience collective ne s’y loge plus sans perte.
La logique invisible du collectif
Toute société repose sur un ensemble de conventions perceptives partagées. Ces conventions ne se limitent pas à des normes sociales explicites ou à des catégories discursives. Elles s’inscrivent plus profondément dans ce que l’on pourrait appeler un régime d’intelligibilité optique, c’est-à-dire une structuration préalable de ce qui peut être vu, entendu, ressenti et pensé. Ce régime, bien qu’invisible, n’est pas abstrait : il se manifeste par la stabilité apparente du monde commun. Il définit ce qui est considéré comme réel, ce qui est perçu comme valide, et ce qui, à l’inverse, est disqualifié d’emblée — non parce qu’il serait faux, mais parce qu’il est impensable dans les coordonnées du système.
La logique du collectif est donc opératoire, et non simplement symbolique.
Elle configure le champ du visible en imposant des lignes de focalisation partagées :
– certains objets deviennent évidents,
– certaines émotions sont lisibles,
– certains récits circulent librement,
– d’autres, bien que présents, ne franchissent pas les seuils d’apparition.
Ce processus est rarement conscient. Il ne repose ni sur une volonté centrale, ni sur un dogme déclaré.
Il fonctionne plutôt comme une gravité perceptive, une tension normative qui contraint doucement les subjectivités à s’aligner, pour préserver la cohésion du champ commun.
Ce que la psychooptique met ici en évidence, c’est que ce système ne tolère pas tous les angles.
Il favorise les regards qui renforcent la stabilité optique globale, et marginalise — activement ou passivement — ceux qui la déstabilisent. Autrement dit, ce qui ne cadre pas n’est pas simplement ignoré : il est recodé comme perturbation. Cette logique s’exerce à travers tous les dispositifs de médiation collective :
le langage, l’instruction, les médias, les algorithmes, les pratiques culturelles, mais aussi — plus insidieusement — à travers les normes affectives et les formes admises d’attention.
On ne dit pas "ne vois pas cela". On fait en sorte que "cela" n’apparaisse pas comme une possibilité de vision.
Ainsi, les subjectivités en dissonance optique — celles qui perçoivent des intensités, des ruptures de pattern, des réseaux de sens inaperçus — se retrouvent face à une alternative impossible :
– soit se conformer à un cadre qui ne les contient plus,
– soit s’exclure d’un champ de visibilité dans lequel elles deviennent illisibles.
La souffrance, dès lors, ne naît pas d’un défaut individuel, mais d’une pression structurelle.
Elle marque le point de friction entre une conscience qui capte autre chose, et un système qui ne peut encore le rendre intelligible. La logique invisible du collectif fonctionne donc comme un mécanisme de préservation de la lisibilité du monde. Mais ce mécanisme, pour rester stable, doit régulièrement produire de l’exclusion optique — c’est-à-dire rejeter hors-champ ce qui pourrait ouvrir d’autres axes de perception.
La psychooptique, en nommant cette dynamique, n’appelle ni à la rupture, ni à la révolte.
Elle cherche à décrire le coût cognitif de la stabilité collective, et à rendre pensable que certains malaises dits "intimes" sont en réalité les effets d’un cadrage structurel qui sature.
L’enjeu n’est pas de supprimer le collectif, mais de le rendre plus souple à l’émergence de nouvelles focales.
Autrement dit : non pas abolir le cadre, mais créer des conditions pour que d’autres régimes du visible puissent l’habiter.
La logique du collectif est donc opératoire, et non simplement symbolique.
Elle configure le champ du visible en imposant des lignes de focalisation partagées :
– certains objets deviennent évidents,
– certaines émotions sont lisibles,
– certains récits circulent librement,
– d’autres, bien que présents, ne franchissent pas les seuils d’apparition.
Ce processus est rarement conscient. Il ne repose ni sur une volonté centrale, ni sur un dogme déclaré.
Il fonctionne plutôt comme une gravité perceptive, une tension normative qui contraint doucement les subjectivités à s’aligner, pour préserver la cohésion du champ commun.
Ce que la psychooptique met ici en évidence, c’est que ce système ne tolère pas tous les angles.
Il favorise les regards qui renforcent la stabilité optique globale, et marginalise — activement ou passivement — ceux qui la déstabilisent. Autrement dit, ce qui ne cadre pas n’est pas simplement ignoré : il est recodé comme perturbation. Cette logique s’exerce à travers tous les dispositifs de médiation collective :
le langage, l’instruction, les médias, les algorithmes, les pratiques culturelles, mais aussi — plus insidieusement — à travers les normes affectives et les formes admises d’attention.
On ne dit pas "ne vois pas cela". On fait en sorte que "cela" n’apparaisse pas comme une possibilité de vision.
Ainsi, les subjectivités en dissonance optique — celles qui perçoivent des intensités, des ruptures de pattern, des réseaux de sens inaperçus — se retrouvent face à une alternative impossible :
– soit se conformer à un cadre qui ne les contient plus,
– soit s’exclure d’un champ de visibilité dans lequel elles deviennent illisibles.
La souffrance, dès lors, ne naît pas d’un défaut individuel, mais d’une pression structurelle.
Elle marque le point de friction entre une conscience qui capte autre chose, et un système qui ne peut encore le rendre intelligible. La logique invisible du collectif fonctionne donc comme un mécanisme de préservation de la lisibilité du monde. Mais ce mécanisme, pour rester stable, doit régulièrement produire de l’exclusion optique — c’est-à-dire rejeter hors-champ ce qui pourrait ouvrir d’autres axes de perception.
La psychooptique, en nommant cette dynamique, n’appelle ni à la rupture, ni à la révolte.
Elle cherche à décrire le coût cognitif de la stabilité collective, et à rendre pensable que certains malaises dits "intimes" sont en réalité les effets d’un cadrage structurel qui sature.
L’enjeu n’est pas de supprimer le collectif, mais de le rendre plus souple à l’émergence de nouvelles focales.
Autrement dit : non pas abolir le cadre, mais créer des conditions pour que d’autres régimes du visible puissent l’habiter.
Ce que la conscience capte malgré elle
La conscience est fréquemment pensée comme un centre d’initiative, de décision et d’intention. Héritière d’une longue tradition philosophique, cette conception volontariste lui attribue la fonction de commandement : elle serait le lieu où les pensées sont produites, les choix formulés, les perceptions interprétées. Pourtant, dès que l’on s’éloigne des abstractions pour s’ancrer dans l’expérience phénoménologique la plus fine, cette représentation montre ses limites.
Ce que la psychooptique met en lumière, c’est un déplacement de statut : la conscience ne serait pas une instance émettrice, mais une surface de réception, de modulation et de filtrage. Elle n’initie pas le réel ; elle le sélectionne, l’oriente, l’organise selon des paramètres souvent non choisis. Dès lors, ce que nous croyons "penser" n’est pas nécessairement le produit de notre volonté rationnelle. Ce que nous croyons "percevoir" ne dépend pas exclusivement de notre curiosité, ni même de notre subjectivité personnelle. Une part non négligeable de ce que nous appelons “expérience consciente” s’impose à nous — sans autorisation, sans justification, sans cause apparente.
La conscience capte. Elle capte ce qu’elle ne comprend pas encore. Elle capte avant que le langage n’arrive.
Elle capte parfois contre la volonté du sujet. Cette captation peut prendre plusieurs formes :
– une intuition sans fondement logique,
– une impression persistante sans objet clair,
– un élan ou un retrait sans raison apparente,
– une image intérieure qui ne répond à aucun souvenir,
– une intensité affective disproportionnée à la situation présente.
Dans la logique psychooptique, ces phénomènes ne sont ni accessoires ni pathologiques. Ils sont les signaux précoces d’un autre régime perceptif en train de s’amorcer. Ils révèlent que la conscience est traversée par des flux qui ne viennent pas d’elle-même, mais qui cherchent à s’y manifester. Il serait donc erroné de penser que nous contrôlons ce que nous percevons. En réalité, nous sommes le lieu par lequel quelque chose perçoit — à travers nous. Et tant que cette chose n’est pas reconnue, formulée ou incarnée, elle se manifeste sous forme de tension, d’inconfort ou de distorsion.
Ce n’est pas là une posture mystique, mais une inférence structurale : si la conscience est un instrument optique, alors elle peut être orientée, polarisée, détournée par des forces — collectives, historiques, systémiques ou encore émergentes — qui excèdent la simple individualité.
Ce que l’on appelle parfois "hypersensibilité", "intuition exagérée", "pensée divergente", pourrait en ce sens relever non pas d’un excès psychique, mais d’une exposition anticipée à des configurations du réel encore instables.
La conscience capte malgré elle — et c’est là peut-être sa fonction la plus humaine. Non pas vouloir, mais recevoir. Non pas affirmer, mais abriter ce qui n’a pas encore de lieu. Ainsi, le malaise qui naît de ces captations ne vient pas tant du contenu perçu que de l’absence de structure d’accueil dans le cadre existant.
Le sujet souffre non parce qu’il voit quelque chose de faux, mais parce qu’il voit quelque chose que personne n’est encore prêt à reconnaître.
La psychooptique, en formulant cela, ne propose pas de résolution. Elle ne transforme pas cette captation en pouvoir. Elle affirme simplement qu’il est épistémologiquement légitime de considérer la conscience comme traversée, et non comme souveraine. Et que le premier geste face à cela n’est pas de corriger l’expérience,
mais de renforcer la capacité à rester debout dans l’instable, jusqu’à ce que ce qui nous traverse trouve forme.
Ce que la psychooptique met en lumière, c’est un déplacement de statut : la conscience ne serait pas une instance émettrice, mais une surface de réception, de modulation et de filtrage. Elle n’initie pas le réel ; elle le sélectionne, l’oriente, l’organise selon des paramètres souvent non choisis. Dès lors, ce que nous croyons "penser" n’est pas nécessairement le produit de notre volonté rationnelle. Ce que nous croyons "percevoir" ne dépend pas exclusivement de notre curiosité, ni même de notre subjectivité personnelle. Une part non négligeable de ce que nous appelons “expérience consciente” s’impose à nous — sans autorisation, sans justification, sans cause apparente.
La conscience capte. Elle capte ce qu’elle ne comprend pas encore. Elle capte avant que le langage n’arrive.
Elle capte parfois contre la volonté du sujet. Cette captation peut prendre plusieurs formes :
– une intuition sans fondement logique,
– une impression persistante sans objet clair,
– un élan ou un retrait sans raison apparente,
– une image intérieure qui ne répond à aucun souvenir,
– une intensité affective disproportionnée à la situation présente.
Dans la logique psychooptique, ces phénomènes ne sont ni accessoires ni pathologiques. Ils sont les signaux précoces d’un autre régime perceptif en train de s’amorcer. Ils révèlent que la conscience est traversée par des flux qui ne viennent pas d’elle-même, mais qui cherchent à s’y manifester. Il serait donc erroné de penser que nous contrôlons ce que nous percevons. En réalité, nous sommes le lieu par lequel quelque chose perçoit — à travers nous. Et tant que cette chose n’est pas reconnue, formulée ou incarnée, elle se manifeste sous forme de tension, d’inconfort ou de distorsion.
Ce n’est pas là une posture mystique, mais une inférence structurale : si la conscience est un instrument optique, alors elle peut être orientée, polarisée, détournée par des forces — collectives, historiques, systémiques ou encore émergentes — qui excèdent la simple individualité.
Ce que l’on appelle parfois "hypersensibilité", "intuition exagérée", "pensée divergente", pourrait en ce sens relever non pas d’un excès psychique, mais d’une exposition anticipée à des configurations du réel encore instables.
La conscience capte malgré elle — et c’est là peut-être sa fonction la plus humaine. Non pas vouloir, mais recevoir. Non pas affirmer, mais abriter ce qui n’a pas encore de lieu. Ainsi, le malaise qui naît de ces captations ne vient pas tant du contenu perçu que de l’absence de structure d’accueil dans le cadre existant.
Le sujet souffre non parce qu’il voit quelque chose de faux, mais parce qu’il voit quelque chose que personne n’est encore prêt à reconnaître.
La psychooptique, en formulant cela, ne propose pas de résolution. Elle ne transforme pas cette captation en pouvoir. Elle affirme simplement qu’il est épistémologiquement légitime de considérer la conscience comme traversée, et non comme souveraine. Et que le premier geste face à cela n’est pas de corriger l’expérience,
mais de renforcer la capacité à rester debout dans l’instable, jusqu’à ce que ce qui nous traverse trouve forme.
Auteur: Anastasia Beschi
08/09/2025
08/09/2025
Abonnez-vous à notre newsletter et restez informé des dernières tendances du monde du dating
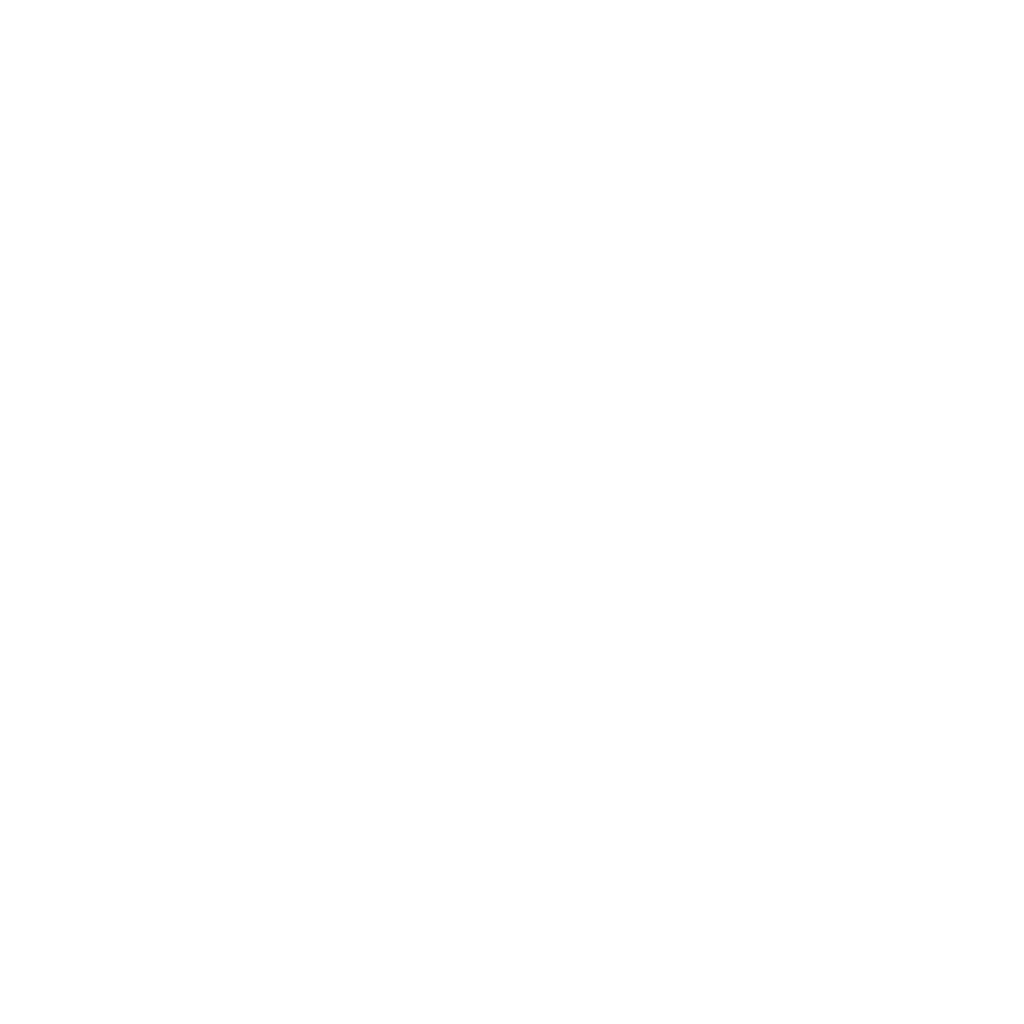
ZONE DESSERVIE
PAR CITROMANTIC
PAR CITROMANTIC
FRANCE
- AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
- CENTRE-VAL DE LOIRE
- ÎLE-DE-FRANCE
- PAYS DE LA LOIRE
- Ain, Allier, Ardèche
- Cantal, Drôme, Isère
- Loire, Haute-Loire
- Puy-de-Dôme, Rhône
- Savoie, Haute-Savoie
- Côte-d’Or, Doubs, Alpes-Maritimes
- Jura, Nièvre, Haute-Saône
- Saône-et-Loire, Yonne
- Calvados, Eure, Manche
- Orne, Seine-Maritime
- Vienne, Haute-Vienne
- Ariège, Aude, Aveyron
- Maine-et-Loire, Mayenne
ILE DE FRANCE
- BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
- CORSE, GRAND EST
- NORMANDIE
- OCCITANIE
- Hautes-Pyrénées, Loiret
- Côtes-d’Armor, Val-de-Marne
- Finistère, Ille-et-Vilaine
- Morbihan, Cher, Val-d’Oise
- Eure-et-Loir, Indre
- Indre-et-Loire, Hauts-de-Seine
- Loir-et-Cher, Bouches-du-Rhône
- Corse-du-Sud, Seine-Saint-Denis
- Charente, Charente-Maritime
- Corrèze, Creuse, Dordogne
- Gard, Haute-Garonne, Gers
- Pyrénées-Orientales, Tarn
- Sarthe, Vendée, Hautes-Alpes
PARIS
- BRETAGNE
- HAUTS-DE-FRANCE
- NOUVELLE-AQUITAINE
- PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
- Haute-Corse, Ardennes
- Aube, Marne, Haute-Marne
- Meurthe-et-Moselle
- Meuse, Moselle, Vosges
- Bas-Rhin, Haut-Rhin
- Aisne, Nord, Somme, Var
- Pas-de-Calais, Seine-et-Marne
- Yvelines, Essonne, Vaucluse
- Gironde, Landes, Lot-et-Garonne
- Pyrénées-Atlantiques, Deux-Sèvres
- Hérault, Lot, Lozère
- Tarn-et-Garonne, Loire-Atlantique
- Alpes-de-Haute-Provence

